EDITO – Maltraitance institutionnelle… la subissez-vous, vous aussi?
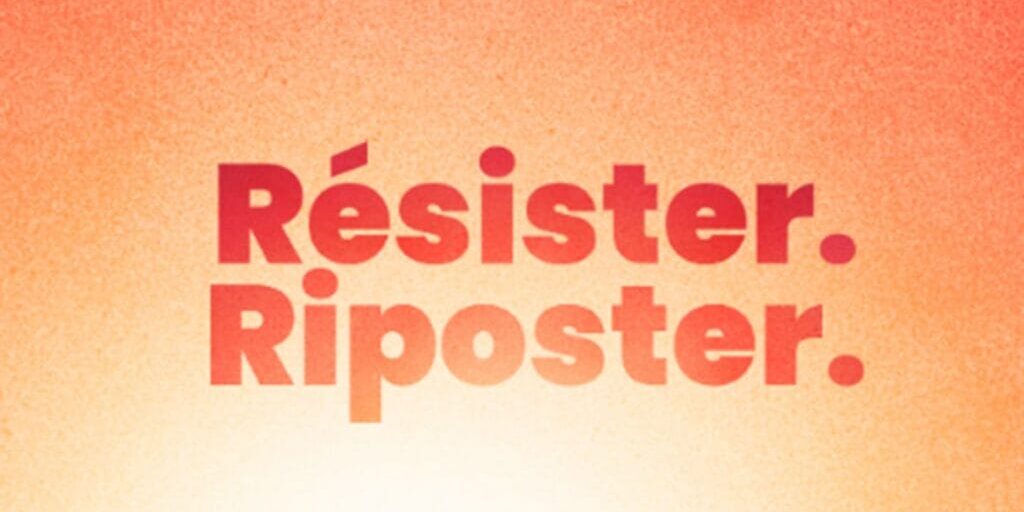
Les observez-vous, les ressentez-vous, les subissez-vous vous aussi? Les pressions s’intensifient! Les pressions que mettent nos gouvernements sur notre projet d’une économie sociale et solidaire, sur nos projets associatifs et coopératifs augmentent de jour en jour. Plutôt que d’être soutenus et encouragés, plutôt que d’être invités à coconstruire des politiques publiques basées sur nos expérimentations, sur nos innovations sociales, les politiques actuelles détricotent parfois d’un seul geste ce que nous avons collectivement bâti, parfois sur plusieurs décennies. Baisse ou arrêt des financements, retards bureaucratiques, vacance du pouvoir exécutif à Bruxelles, exigence de justifications nous assujettissant à des normes externes à l’esprit de nos activités, etc. Ces éléments épars s’accumulent et constituent finalement ce qu’il faut bien appeler «maltraitance institutionnelle». De cette maltraitance, nous sommes en droit de nous demander si elle n’est pas intentionnelle. Les incertitudes sur nos avenirs associatifs et coopératifs s’additionnent aux incertitudes sur l’avenir démocratique, écologique et de justice sociale de nos sociétés.
Et les mesures annoncées ne sont pas meilleures. Elles pourraient même nous faire basculer dans une autre dimension, celle de la fin de la liberté et de l’autonomie associative, celle de la fin de la liberté d’expression, celle de la fin de la démocratie culturelle qui entend rapprocher les citoyens des centres de décision en suscitant la prise de responsabilité, l’engagement et la participation à la chose publique, celle de la fin de l’Etat de droit. Ainsi, l’un de nos gouvernements a le projet de limiter la reconnaissance d’associations sur la base de critères politiques. Ainsi, l’un de nos gouvernements a le projet d’une procédure accélérée de dissolution administrative d’une association ou d’un groupement de fait. Cela, alors que depuis quatre ans et pour la première fois depuis 1945, notre gouvernement bafoue lui-même la Constitution et nos règles démocratiques fondamentales en laissant lettre morte des décisions de justice qui le contraignent en matière d’accueil des demandeur·euses d’asile.
Que faire? Comment résister et riposter? Paraphrasant le philosophe Yves Citton, pour «renverser l’insoutenable»[1], il faut investir une politique des gestes, c’est-à-dire des expérimentations, des contre-conduites, qui en entraînent d’autres, qui contaminent, qui sont mimées de proche en proche, jusqu’à faire contrepoids aux politiques gestionnaires.
Quels sont ces gestes qu’il est urgent de commettre?
Nous vous en proposons quelques-uns:
- Se rappeler nos valeurs et les revendiquer, par exemple Les Grignoux qui osent afficher un drapeau palestinien sur leurs bâtiments, qui programment le film « Put Your Soul on Your Hand and Walk » de Sepideh Farsi, qui publient une étude sur la manière dont le cinéma peut faire passer du statut de spectateur·rice à celui de protagoniste, qui résistent aux interpellations d’élus locaux et affirment jouer pleinement leur rôle politique.
- Comprendre ce qui nous arrive en prenant de la hauteur et en anticipant, par exemple en participant à cette Journée des chantiers de l’ESS ou qui participerez à l’événement « Ce qui nous arrive » des 11 et 12 décembre organisé notamment par la Fédération des services sociaux. Voici ce qui est dit en préparation à cette rencontre: «Nous voyons bien que ce qui advient rebat les cartes, à une vitesse tellement accélérée qu’elle empêche de distinguer exactement comment les dévastations sociales, environnementales, culturelles, s’enchaînent et s’aggravent. Nous continuons à jouer, mais l’échiquier n’est plus le même, le socle a changé et nos repères se retrouvent sens dessus dessous. Nous ne sommes plus tout à fait certain·es que nos actions, que notre travail même, soient encore considérés comme essentiels: nos moyens diminuent, voire s’effacent. Notre moral collectif est atteint. Dans cette situation, comment s’organiser au mieux, comment économiser énergie et moyens mais comment aussi questionner nos rapports aux institutions avec lesquelles nous avons jusque-là accepté de signer un pacte social que nous sommes les derniers à respecter?»
- Renforcer la solidarité entre nous malgré la restriction des financements et les risques de plus grande concurrence, par exemple ce récent lancement de l’Alliance Otonom[2], qui résulte d’une volonté de mutualisation entre huit associations. Sans effacer les singularités de ses membres, cette alliance s’appuie sur la confiance mutuelle en vue de gagner en clarté, en solidité, en efficacité et d’affronter ensemble les tempêtes.
- Tisser des alliances entre acteurs associatifs et d’ESS et syndicats, par exemple cet appel des Amis de la Terre à l’organisation d’une Assemblée Générale de Résistance en amont de quatre jours de mobilisation syndicale de cette fin du mois de novembre. Appel venant en réaction aux nombreuses attaques, non seulement contre la sécurité sociale (chômage, pensions, accès aux soins de santé) mais aussi contre les services publics comme l’école, contre les enjeux écologiques les plus fondamentaux. Le gouvernement attaque aussi les salaires, le pouvoir d’achat, les allocations. Et bien sûr les contre-pouvoirs démocratiques que constituent les syndicats, le monde associatif, la presse indépendante, la culture et l’université, ces espaces où se pensent et se construisent des alternatives à cet ordre social capitaliste d’une grande violence. Cette assemblée a pour objectif de rassembler, au-delà d’un seul secteur, et d’élaborer une stratégie et un plan d’action concerté, articulé au plan d’action syndical, pour contribuer à construire un rapport de force face au gouvernement et au système économique capitaliste qu’il représente.
- Protéger les plus faibles d’entre nous et ceux qui en prennent soin, comme par exemple les sage-femmes du CHU Saint-Pierre qui se sont mises en grève pour dénoncer la «marchandisation» de l’hôpital public et qui seront les premières victimes de la réforme des pensions décidée par un gouvernement machiste. Les restructurations successives menacent directement la qualité des soins. L’une d’entre elles explique: «Les soignants sont fatigués. On ne peut pas faire des économies sur nous. La qualité du travail, c’est le temps qu’on prend avec les patients, ce sont les explications qu’on donne, ce ne sont pas les actes qu’on fait, c’est la possibilité de demander le consentement à chaque acte. C’est la possibilité d’expliquer pour que les patients puissent participer à leurs soins. Et ça, malheureusement, ça ne se tarife pas»[3].
- Confronter les acteurs politiques irresponsables, par exemple avec cette récente carte blanche initiée par le Gresea et SAW-B, intitulée «Qui sont les assistés?»[4] dénonçant le deux poids deux mesures entre le soutien public aux entreprises et les subventions aux associations et autres acteurs de l’intérêt général et du bien commun, entre l’absence de redevabilité des uns et l’accumulation des contrôles envers les autres, entre l’image de créateurs de richesse ruisselantes qui colle aux premiers et la vision de quémandeurs qu’ont certains politiques des seconds. Le soutien public (par le biais de subventions, de réductions d’impôts ou de cotisations de Sécurité sociale) aux entreprises privées lucratives est estimé à près de 52 milliards d’euros en 2022, ce qui représente 9,2% du PIB, 17,6% des dépenses publiques, 115,4% des dépenses de santé et 1,5 fois le budget de l’enseignement. Imaginez ce qui pourrait être fait d’une telle somme!
Vous avez très certainement en tête d’autres gestes de résistance et de riposte, comme celui de «redonner toute sa place à la joie comme moteur de lutte et d’émancipation»[5].
A l’instar d’un groupe de musique ou d’un orchestre, travaillons à ce que de plus en plus d’acteurs «se sentent participer à un même geste commun, quoiqu’ils exécutent tous des gestes très différents entre eux»[6]. Une telle mobilisation collective peut certainement transformer les gestes associatifs anciens en nouveaux vecteurs de renversements des pressions.
Musique! (écoutez par exemple «Berghain» de Rosalίa)
[1] Yves Citton, Renverser l’insoutenable, Seuil, 2012.
[2] Voir : https://allianceotonom.be/
[3] https://bx1.be/categories/news/90-des-sages-femmes-du-chu-saint-pierre-en-greve-je-devrai-un-jour-peut-etre-renoncer-a-ce-que-jaime-le-plus/
[4] https://www.lalibre.be/debats/opinions/2025/10/11/qui-sont-les-assistes-UZBIJTFMAJEVBKLFR6QQIGK2IU/
[5] Kiyemis (coord.), Pour la joie. Une ode à la résistance poétique et politique, Les liens qui libèrent, 2025.
[6] Vanille Goovaerts, citée par Quentin Mortier, « Pratiques délibératives et participatives, des leviers de dynamique interne », dans Patricia Coler, Marie-Catherine Henry, Jean-Louis Laville, Gilles Rouby (dir.), Quel monde associatif demain ? Mouvements citoyens et démocratie, ERES, 2021.
Ce texte a été prononcé lors de la journée de Chantiers de l’économie sociale par Quentin, copilote de SAW-B, entouré de plusieurs membres de l’équipe.
Partagez :




